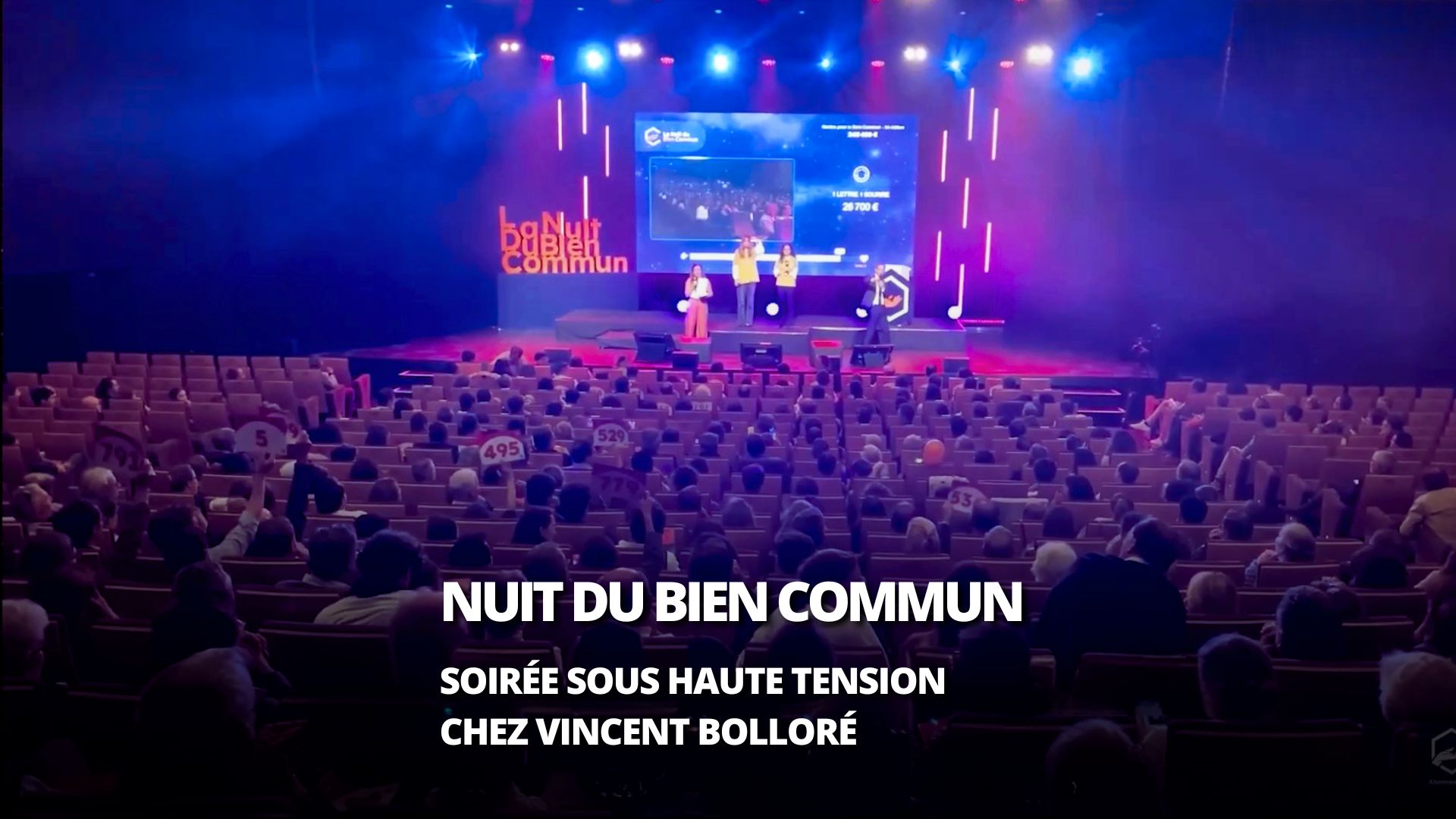En cette année internationale des coopératives proclamée par l’ONU, Jérôme Saddier, président du Crédit Coopératif et du mouvement Coop FR, se trouve aujourd’hui à Manchester pour la 103e Journée internationale des coopératives. Dans notre émission, il sonne l’alerte sur les faillites d’associations et sur les fragilités de l’économie sociale et solidaire face à la crise budgétaire. Il défend la pertinence du modèle coopératif comme levier de transformation économique et sociale, mais il reconnaît que les bouleversements du monde font bouger les lignes : le Crédit Coopératif investira-t-il un jour dans l’armement, pour contribuer à l’effort de défense du pays ? Dans notre émission, il ouvre le débat !
Savez-vous pourquoi des centaines de coopératives vont ouvrir leurs portes au public le 5 juillet ? Savez-vous que l’ONU a proclamé l’année 2025 Année internationale des coopératives ? Savez-vous pourquoi l’Alliance Coopérative Internationale tenait hier son assemblée générale dans la ville de Manchester, en Grande-Bretagne ? Et connaissez-vous les grandes marques coopératives qui imprègnent le quotidien des Français, que sont Biocoop, le Crédit Mutuel, Système U (renommé Coopérative U), Intersport, JouéClub, Atol, la Caisse d’Épargne…
Et bien sachez que c’est en 1844, à Manchester, que 28 tisserands britanniques ont créé la première coopérative au monde, un magasin d’un nouveau genre : une coopérative ouvrière, nous explique Jérôme Saddier, président du Crédit Coopératif et de Coop FR, invité dans l’émission vidéo « ESS On Air » de Mediatico (voir la vidéo en intégralité ci-dessous).
180 ans plus tard, devant une dynamique coopérative internationale en plein développement parce qu’elle porte les espoirs d’un monde meilleur, l’Alliance Coopérative Internationale organise cette semaine un programme d’activités coopératives, du 2 au 5 juillet 2025, avec en point d’orgue des journées portes ouvertes dans toutes les coopératives volontaires.
À l’heure où le modèle dominant montre ses limites, ce n’est pas un hasard si le modèle coopératif regagne du terrain, nous dit Jérôme Saddier :
« En période de crise, le modèle coopératif revient au centre des débats. Il attire parce qu’il repose sur une gouvernance démocratique, une finalité d’utilité collective, une résilience économique et une capacité d’innovation sociale. »
L’année 2025, proclamée Année internationale des coopératives par l’ONU, donne à cette dynamique un écho mondial. En France, une campagne de communication récente — « Avec OO on change le monde » — portée par le mouvement coopératif des Licoornes, témoigne de cette ambition. Mais ce regain de visibilité intervient dans un contexte tendu, voire inquiétant, pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Une vague silencieuse de défaillances dans l’ESS
Jérôme Saddier, qui est aussi président du Crédit Coopératif, banque historique de l’ESS, observe avec inquiétude la santé économique du secteur. Et les nouvelles ne sont pas bonnes :
« On observe clairement une contraction de l’activité chez nombre de nos clients. La consommation baisse, les ressources publiques se tarissent, et les associations sont en première ligne. »
Le secteur associatif, pilier de l’ESS, voit ses modèles économiques sérieusement mis à mal. Moins de subventions, fin des contrats aidés, fragilité des fonds propres, manque de marges de manœuvre : autant de facteurs qui accélèrent les défaillances.
« Depuis le début de l’année, plusieurs centaines d’associations ont été mises en liquidation, ce qui est rarissime. Une association peut disparaître en fusionnant ou en s’éteignant doucement. Là, on parle de liquidations judiciaires. Et certaines de ces structures sont gestionnaires de services essentiels. Elles disparaissent sans solution de remplacement. »
Selon lui, ce phénomène pourrait bien annoncer une crise sociale larvée : disparition de services de proximité, isolement des publics fragiles, désengagement du tissu citoyen.
Une cellule de veille nationale encore incomplète
Jérôme Saddier réagit aussi dans notre émission à la décision du gouvernement de mettre en place une cellule nationale de veille sur les défaillances dans l’ESS, à la demande d’ESS France [dont Jérôme Saddier a été président], du Mouvement Associatif et de l’Union des Employeurs de l’ESS (UDES). Jérôme Saddier salue l’initiative, mais il la juge insuffisante :
« C’est une bonne chose que cette cellule voie le jour, mais elle reste encore incomplète. Les coopératives n’en font pas partie. Les banquiers non plus. Ce sont pourtant des acteurs clés. »
L’objectif de cette cellule : anticiper les difficultés des structures de l’ESS à l’échelle territoriale, et proposer des solutions pour éviter la défaillance. Mais encore faut-il que les outils suivent. Jérôme Saddier reste prudent :
« Le gouvernement ne semble pas vouloir mettre en place de fonds d’urgence comme pendant le Covid. Il parle de renforcer les dispositifs existants, en mobilisant davantage les financeurs privés », constate-t-il.
Une conférence des financeurs qui pose question
Quant à la conférence des financeurs de l’ESS lancée au printemps, qui vise à mobiliser banques, fonds d’investissement, fondations et assureurs autour d’une stratégie de financement renforcée du secteur, là encore Jérôme Saddier émet des réserves sur la méthode :
« Lors de la première réunion, les ministres ont écouté les acteurs, puis présenté un état des lieux. C’est l’inverse de ce qu’il aurait fallu faire. Il aurait fallu débattre d’un diagnostic partagé. Or le document du Trésor est très incomplet, très en deçà des travaux d’ESS France, ou même de l’évaluation de la loi de 2014. »
Le risque, selon lui, est de passer trop vite à des solutions qui ne répondraient pas aux vrais problèmes, ou qui seraient mal calibrées.
Le Crédit Coopératif, acteur engagé au-delà du financement
Dans ce contexte, le rôle du Crédit Coopératif est crucial. À la fois banque et acteur militant, elle mobilise son expertise financière au service des structures de l’ESS… mais aussi l’épargne solidaire de ses sociétaires et clients.
« En 2024, ce sont plus de 7 millions d’euros qui ont été redistribués à des associations, via l’épargne de partage. Depuis la création de ces produits, plus de 90 millions d’euros ont été versés au monde associatif. »
Ce modèle repose sur un mécanisme de mutualisation volontaire : renoncement à tout ou partie des intérêts, abondement de la banque, choix des causes soutenues.
« Ce n’est pas la banque toute seule. Ce sont ses clients et ses sociétaires qui font un geste solidaire. Et toutes les banques ne le font pas. Je crois qu’on est les seuls. »
Sous le slogan « 100 % engagé », le Crédit Coopératif affirme plus que jamais son identité. Une banque pas comme les autres, qui assume des choix économiques, sociaux et éthiques. « Être une banque différente, c’est faire son métier autrement. Ce n’est pas un supplément d’âme. C’est au cœur de notre modèle (…) Nous finançons des projets qui s’alignent avec notre vision de la société. »
Faut-il financer l’armement ? Un débat stratégique s’ouvre
Pour autant, le monde change, promettant des débats difficiles. Une question délicate traverse aujourd’hui la banque : faut-il continuer de refuser de financer toute activité liée à l’armement ? Une position historique, liée aux campagnes contre les mines antipersonnelles dans les années 1970. Mais aujourd’hui, la donne géopolitique a changé.
« Peut-on se dire « responsable » sans participer à l’effort de souveraineté ? Certains de nos clients nous demandent d’y contribuer. Nous allons consulter nos sociétaires et les réseaux à l’origine de ces engagements, car ce qu’on appelle notre doctrine d’engagement est au cœur de notre identité. On ne peut pas décider seuls. Mais on ne peut pas non plus rester figés dans des postures du passé. »
Le débat sera mené dans les prochaines semaines au sein du conseil d’administration et auprès des parties prenantes du Crédit Coopératif.
Vers une économie du sens
Ce positionnement exigeant est-il un atout de conquête ? Sans hésitation, Jérôme Saddier répond par l’affirmative :
« Les particuliers nous rejoignent parce qu’ils cherchent du sens. Ce n’est pas seulement le mot « coopératif » qui les attire, c’est l’exigence que cela suppose (…) Le modèle coopératif dans son ensemble n’est pas une alternative marginale. C’est une autre manière de faire économie. Une manière plus humaine, plus durable, plus collective. Et c’est ça, aujourd’hui, que le monde attend. »
En période de crise démocratique, sociale et environnementale, et de remise en question de l’État-providence, le modèle coopératif apparaît comme un cap possible. Voire souhaitable.