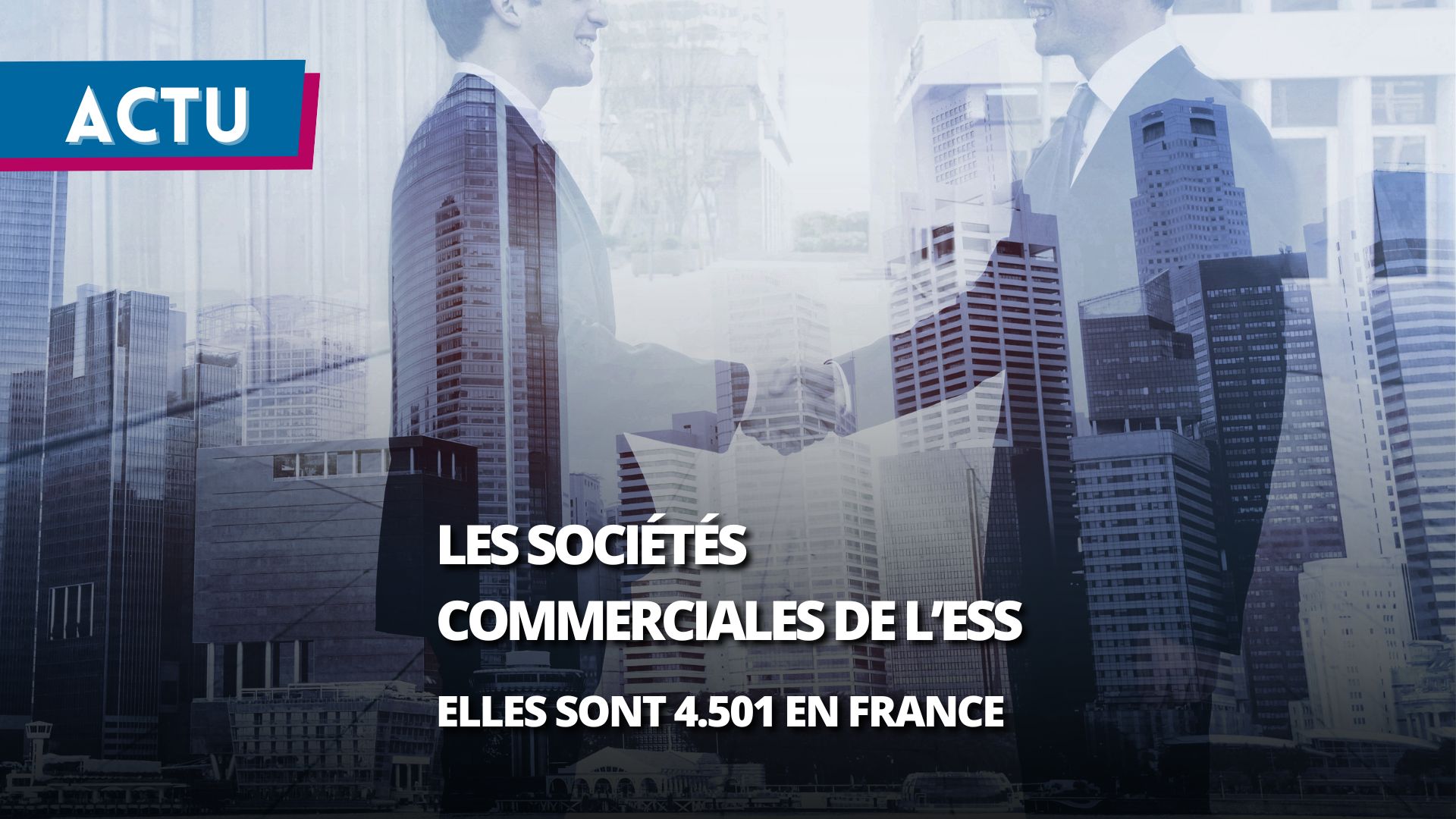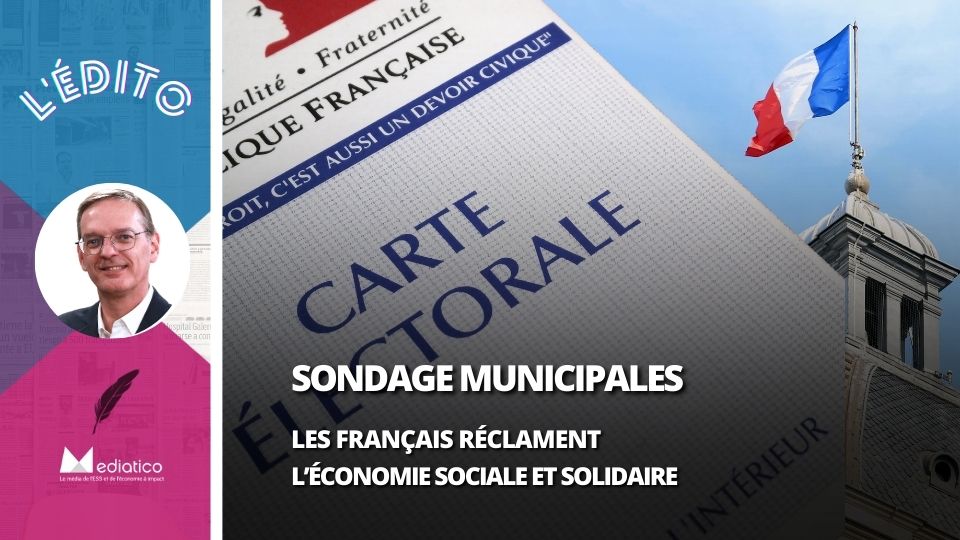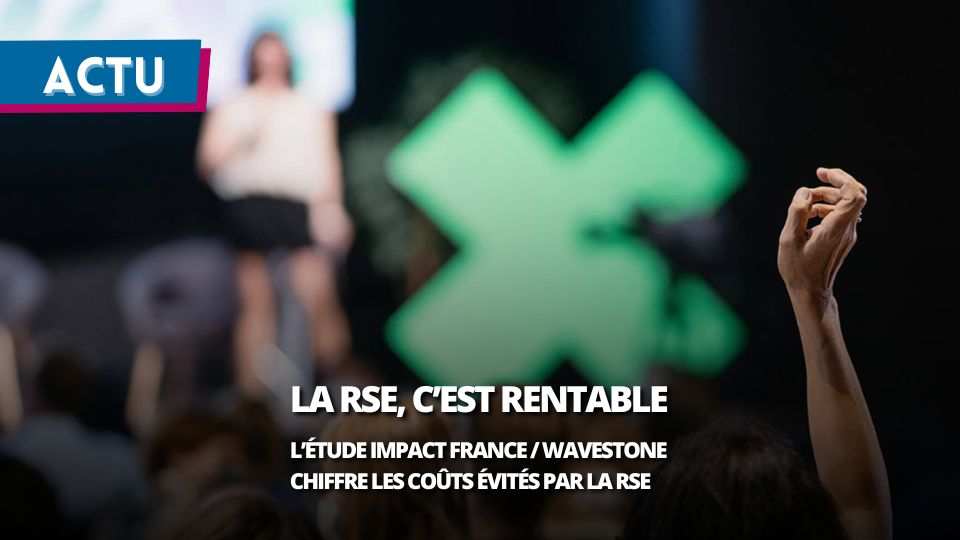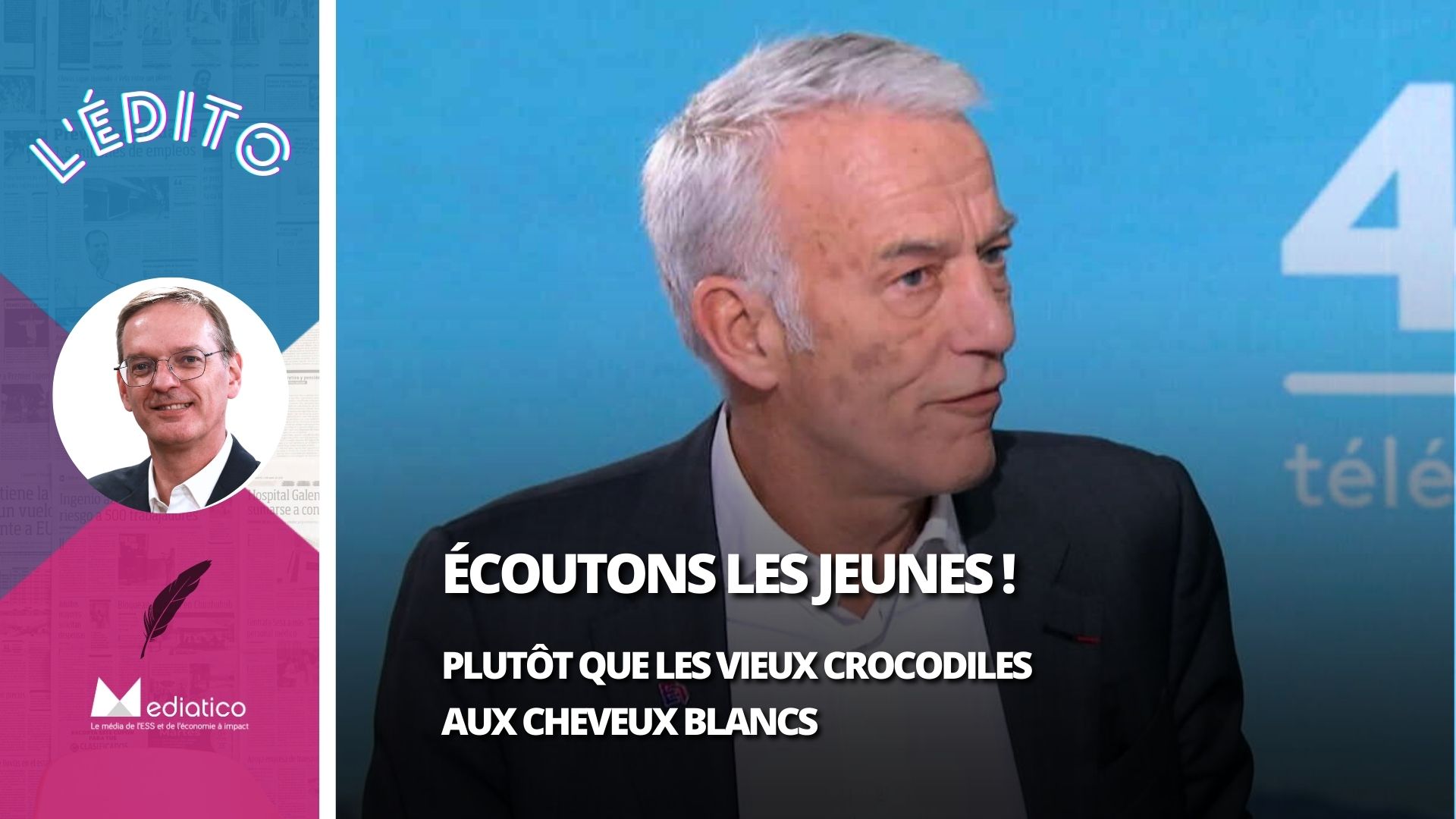ESS France vient de publier un nouveau décompte inédit du paysage des sociétés commerciales de l’ESS, dénombrant 4 501 sociétés commerciales qui ont choisi, en l’espace de dix ans, d’inscrire une finalité d’utilité sociale et une gouvernance démocratique dans leurs statuts.
Depuis la création du statut en 2014, le nombre de sociétés commerciales de l’Économie sociale et solidaire (SCESS) croît ainsi de façon progressive, vraisemblablement plus rapide que celui des entreprises à mission qui sont au nombre de 2000, mais sans toutefois susciter d’emballement outre mesure. Le nombre de 4 501 sociétés commerciales de l’ESS reste en effet marginal dans le bouillonnant paysage statutaire de l’économie sociale et solidaire.
Les SCESS, un poids marginal dans l’économie sociale et solidaire
Tous statuts confondus, l’Avise rappelle que la répartition des 155 000 entreprises employeuses de l’ESS en France s’établissait de la manière suivante au dernier décompte disponible, soit selon les chiffres consolidés de l’année 2022 :
- 120 749 associations soit 79 % des emplois de l’ESS avec 2 millions d’emploi ;
- 23 880 coopératives soit 12 % des emplois de l’ESS avec 313 239 emplois ;
- 7 329 mutuelles soit 5 % des emplois de l’ESS avec 137 738 emplois ;
- 721 fondations soit 0,5 % des emplois de l’ESS avec 122 916 emplois ;
- 2 000 entreprises de l’ESS agréées ESUS (dont 70 % d’association, 19 % de sociétés commerciales de l’ESS et 10 % de coopératives), soit 1,3 % des emplois de l’ESS.
Ce nouveau décompte des sociétés commerciale des l’ESS (SCESS) accroit donc considérablement la part des entreprises agréées ESUS dans le total des structures de l’ESS, tout en maintenant leur nombre en-dessous de 3% du total des structures employeuses.
Pour autant, cette trajectoire témoigne d’un intérêt réel pour cette forme d’entrepreneuriat qui marie les outils du droit commercial (SAS, SARL, etc.) et les engagements de l’ESS : rechercher une utilité sociale, adopter une gouvernance démocratique et affecter la majorité des bénéfices au développement de l’activité.
Des profils variés, des start-ups sociales aux entreprises d’insertion
Les SCESS ne forment pas un bloc homogène. On y trouve aussi bien des start-ups sociales que des filiales commerciales d’associations, des entreprises d’insertion et même des sociétés commerciales qui souhaitent simplement formaliser un engagement social ou éthique.
Leur champ sectoriel est également très large : soutien aux entreprises pour près de 1200 d’entre elles, soit 27% des SCESS, mais aussi commerce, industrie, information et communication, ou encore action sociale et enseignement… Cette diversité fait de la société commerciale de l’ESS un outil flexible, que certains qualifieront de « pont » entre l’économie classique et l’ESS.
Un statut simple à activer, mais encore méconnu
Le processus de reconnaissance est volontaire et relativement simple sur le plan administratif : il suffit d’inscrire les trois conditions dans les statuts, de les approuver en assemblée générale puis de transmettre le dossier au greffe du tribunal de commerce qui vérifie et inscrit la mention « société commerciale de l’ESS » au registre.
Pourtant, derrière cette simplicité formelle se trouvent des enjeux concrets : notoriété encore limitée, cadre juridique parfois perçu comme flou, accompagnement insuffisant et répartition inégale sur le territoire.
Adopter le statut de société commerciale de l’ESS ouvre évidemment quelques portes : accès aux appels à projets et marchés publics réservés à l’ESS, possibilité d’obtenir certains fonds dédiés comme les fonds réemploi, ou encore une meilleure visibilité dans l’écosystème de l’ESS.
SCESS ou ESUS, quelle différence ?
Par ailleurs, 12,4 % des SCESS disposent aujourd’hui de l’agrément ESUS, qui facilite l’accès à la finance solidaire. Ce point est important à relever, car la confusion est fréquente entre le statut de SCESS qui est purement déclaratif et statutaire d’une part, et l’agrément ESUS délivré par l’autorité préfectorale d’autre part.
L’agrément ESUS est en effet un label délivré par l’État, qui reconnaît qu’une structure remplit des critères précis d’utilité sociale, de lucrativité encadrée et de gouvernance adaptée. Mais l’agrément ESUS va plus loin que la déclaration en société commerciale de l’ESS, car l’activité d’une société agréée ESUS doit relever expressément de l’une des catégories d’« utilité sociale » prévues par la loi (insertion, lutte contre les exclusions, éducation populaire, transition écologique, cohésion sociale, etc.).
De plus, les plafonds de rémunération de l’agrément ESUS sont beaucoup plus stricts (l’écart de salaire maximum va de 1 à 7 entre la rémunération la plus basse et la plus haute). Enfin, l’entreprise ESUS a l’obligation d’évaluer et de mesurer son impact social régulièrement : son agrément n’est délivré que pour 5 ans, avant d’être éventuellement renouvelé.
Les recommandations d’ESS France pour développer les SCESS
L’étude de l’Observatoire national de l’ESS, portée par ESS France avec le soutien de partenaires (Banque des Territoires, Caisse d’Épargne…), livre un diagnostic et préconise des pistes pour lever les freins au développement des SCESS. Trois axes structurants ressortent :
- Sécuriser et consolider l’encadrement juridique, pour réduire les zones d’incertitude et faciliter les conversions en SCESS ;
- Renforcer l’environnement institutionnel, mieux informer et former les acteurs (financeurs, collectivités, avocats, experts-comptables) afin qu’ils repèrent et soutiennent ce type de projets ;
- Améliorer la structuration (accompagnement, financement, dispositifs territoriaux) pour permettre aux SCESS de passer à l’échelle.
Un statut prometteur qui demande à mûrir
Les 4 501 SCESS recensées illustrent une dynamique réelle : des entrepreneurs et entreprises veulent conjuguer utilité sociale, gouvernance démocratique et performance économique. Mais pour que ce potentiel devienne un levier national, ESS France plaide pour une meilleure reconnaissance, une sécurisation juridique et des politiques publiques adaptées.
Stabiliser et promouvoir la SCESS, c’est ouvrir de nouvelles fenêtres pour l’ESS. Et pour une économie qui place l’utilité sociale au cœur de l’entreprise.