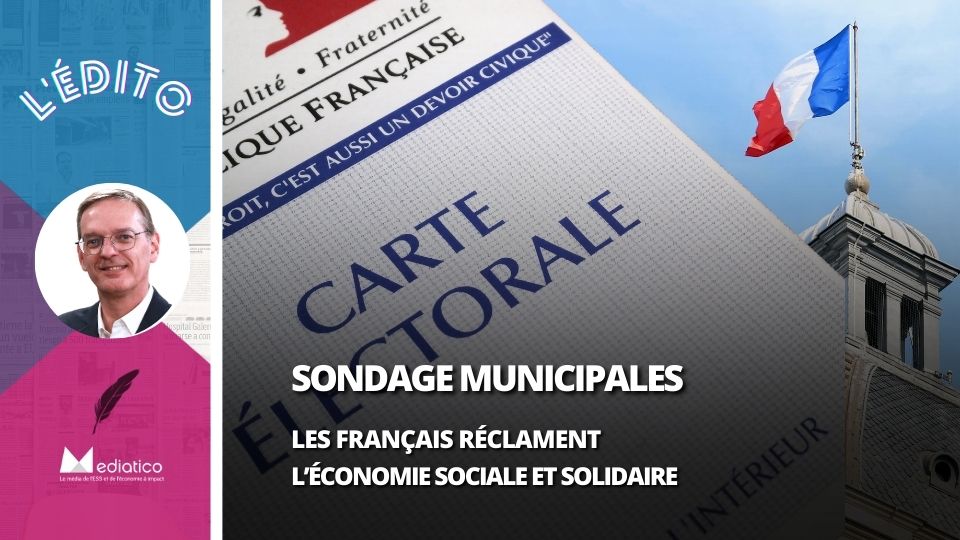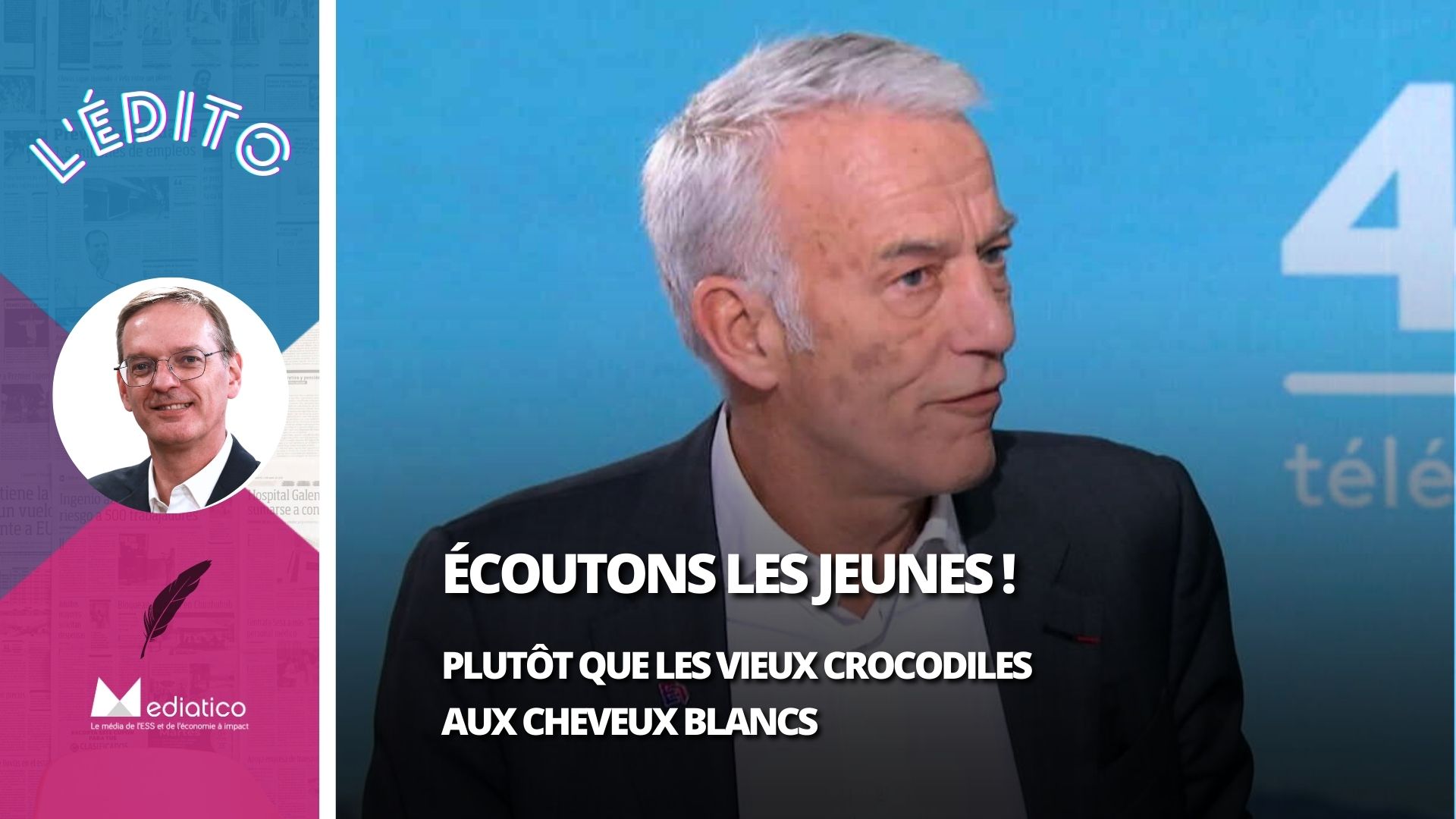Voilà tout juste un mois, Bordeaux s’est transformée en capitale mondiale de l’économie sociale et solidaire, en accueillant durant trois jours l’édition 2025 du Global Social Economy Forum (GSEF). Partenaire média du GSEF, Mediatico a profité de l’occasion pour réaliser sur place, en direct, son émission ESS On Air (à voir en intégralité ci-dessous), pour montrer comment l’économie sociale et solidaire se construit différemment selon les continents, mais aussi en quoi elle les relie.
Sur le plateau de la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine (FRANA), Mediatico a réuni six voix incontournables, un plateau exceptionnel pour un enjeu mondial, que nous vous proposons de retrouver ci-dessous :
- Aude Saldana, secrétaire générale du GSEF
- Margie Mendell, professeure à l’Université Concordia (Montréal)
- Sambou Ndiaye, enseignant-chercheur à l’Université de Saint-Louis (Sénégal)
- Rafael Chaves-Avila, professeur à l’Université de Valence (Espagne)
- Nelly Fesseau, directrice de l’Agence Erasmus+ France – Éducation & Formation
- Timothée Duverger, responsable de la Chaire TerrESS à Sciences Po Bordeaux
Ce dialogue inédit a mis en lumière la diversité, mais aussi les convergences qui structurent aujourd’hui cette ESS mondiale d’une impressionnante vitalité, comme l’a si bien illustré ce GSEF en réunissant plus de 10.000 participants, venus de 109 pays, représentant 907 villes. Quelques chiffres qui constituent un record allant bien au-delà des prévisions initiales, entaché néanmoins par les refus de visas opposés à plusieurs délégations africaines, alors que par nature l’économie sociale et solidaire ne se donne pas de frontières.
Afrique : Une économie réelle, non reconnue par l’économie officielle
Pour Sambou Ndiaye, l’ESS africaine n’est ni marginale ni nouvelle : elle s’ancre dans des pratiques séculaires d’entraide et de solidarité territoriale. « Elle se positionne comme un facteur de résilience des ménages, d’inclusion sociale, de fabrique d’innovation à l’échelle territoriale ». Il rappelle que l’État a montré sa déficience depuis l’indépendance des années 60 et 70, puis que le secteur privé a exploité les ressources naturelles sans respecter les biens communs. Seule l’ESS « a permis aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux ménages de se prendre en charge », en s’appuyant sur les acteurs sociaux, les organisations paysannes, de femmes, ou de jeunes.
Pourtant, il souligne un paradoxe saisissant : au Sénégal, l’ESS représente 70 % de l’emploi et 57 % du PIB, mais elle ne reçoit que 0,1 % du budget national. L’économie sociale et solidaire n’est pas reconnue par l’économie officielle, ce qui l’empêche d’accéder au marché et de se développer davantage. L’enjeu central, selon lui, est la reconnaissance institutionnelle de l’ESS : renforcer le financement, moderniser les unités productives locales, notamment dans l’agro-transformation, et soutenir les organisations communautaires qui structurent la vie économique.
« L’enjeu n’est pas de copier les modèles occidentaux, mais de reconnaître et renforcer nos propres dynamiques », a-t-il martelé, citant l’exemple des unités de transformation solarisées qui permettent aux producteurs ruraux de capter une juste valeur ajoutée. Son plaidoyer pour une justice épistémique – c’est-à-dire la reconnaissance des savoirs endogènes – a résonné comme un appel à décoloniser l’économie. « L’Afrique n’a pas besoin de charité, mais de partenariats équitables qui valorisent son génie collectif », a-t-il conclu, saluant la présence accrue des jeunes et des femmes dans les instances de l’ESS africaine, notamment depuis le GSEF 2023 de Dakar, où le président Macky Sall avait positionné le Sénégal comme plateforme continentale de l’ESS.
Amérique du Nord : le Québec, laboratoire d’une ESS résiliente et transsectorielle
Margie Mendell dresse un portrait contrasté de l’Amérique du Nord, où l’ESS se heurte à des contextes politiques radicalement opposés. Aux États-Unis, l’ESS est souvent stigmatisée par les gouvernements conservateurs, perçue comme une menace à l’ordre libéral. Pourtant, des municipalités progressistes, comme New York ou Seattle, développent des stratégies pour la soutenir, en dépit des politiques fédérales hostiles.
Au Québec, en revanche, l’ESS est structurée, reconnue et financée. Le Chantier de l’économie sociale, réseau unique en son genre, fédère entreprises collectives, mouvements sociaux et acteurs publics. La loi-cadre de 2013 a acté cette reconnaissance, obligeant même les gouvernements les plus réticents à composer avec ce secteur qui pèse 10 % du PIB québécois.
Elle souligne aussi une particularité québécoise : l’ESS ne se limite pas à l’économie. Elle est indissociable des luttes sociales, écologistes et féministes.
« Nous avons appris de l’Amérique latine, de l’Europe, et nous inspirons à notre tour, précise-t-elle. Nos cuisines collectives, nos entreprises d’insertion, nos coopératives de santé sont le fruit d’échanges constants », assure-t-elle. Et de poursuivre : « L’ESS n’est pas une alternative marginale. Elle est un rempart contre les dérives du capitalisme, un laboratoire pour repenser le vivre-ensemble » et une force pour ouvrir des brèches, car « c’est dans les interstices que la lumière entre », conclut-elle, citant le chanteur Leonard Cohen.
Europe : l’Espagne, locomotive d’une ESS plus institutionnalisée mais innovante
Rafael Chaves-Avila a insisté sur le rôle moteur de l’Espagne, où l’ESS n’est plus un simple secteur marginal, mais un pilier reconnu de l’économie et de la transition. « Depuis la loi de 2011, nous avons construit un écosystème unique en Europe », explique-t-il. Les avancées sont multiples, avec notamment une stratégie nationale renforcée, portée par un ministère dédié (Travail et Économie sociale) et une vice-présidente engagée, Yolanda Díaz, qui promeut l’ESS comme levier de résilience face aux crises.
Mais aussi un plan national de relance post-COVID incluant un volet spécifique pour l’ESS, une première en Europe, avec des fonds substantiels pour les coopératives, les entreprises sociales et les initiatives locales. Ou encore une alliance inédite entre acteurs publics, universités et société civile, avec près de 500 chercheurs mobilisés pour documenter et accompagner les transitions. Depuis 2023, l’ESS est aussi officiellement intégrée comme domaine de connaissance dans les universités espagnoles, une avancée symbolique pour former les nouvelles générations.
Pour Rafael Chaves-Avila, cette institutionnalisation n’est pas un hasard : « L’ESS répond aux défis que ni l’État ni le marché ne parviennent à résoudre. Elle est la preuve qu’une autre économie est possible, ancrée dans les territoires et tournée vers l’intérêt général. » L’Espagne, souvent citée en exemple, montre comment une politique publique volontariste peut démultiplier l’impact des initiatives locales, des coopératives énergétiques andalouses aux entreprises d’insertion catalanes.
Erasmus+ : l’Europe comme accélérateur de l’innovation sociale
Nelly Fesseau, directrice de l’Agence Erasmus+ France, a rappelé le rôle clé de l’UE dans le financement des projets transnationaux. Avec 21 millions d’euros dédiés à l’éducation des adultes en 2026, le programme soutient des initiatives phares : CAPS, un projet franco-belgo-espagnol pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les instances dirigeantes de l’ESS ; T-LX et Cyclotopia, des réseaux européens qui expérimentent des modèles de mobilité durable et d’économie circulaire ; ou encore le travail alternatif payé à la journée, une innovation sociale pour les jeunes en précarité, testée dans plusieurs pays.
« Erasmus+ n’est pas qu’un programme de mobilité, souligne-t-elle. C’est un levier pour faire dialoguer les acteurs, comparer les pratiques et accélérer les transitions. » Un outil précieux pour les organisations de l’ESS, souvent en quête de financements et de visibilité.
« L’objectif est de démocratiser l’accès aux compétences et de créer des ponts entre les écosystèmes locaux et européens », a précisé Nelly Fesseau, rappelant que les acteurs de l’ESS sont désormais prioritaires dans les appels à projets. « Nous voulons que chaque euro dépensé serve à renforcer la résilience des territoires et à faire émerger des modèles reproductibles », a-t-elle ajouté, insistant sur l’importance de la coopération interculturelle pour répondre aux défis climatiques et sociaux.
Asie : la Corée du Sud et la puissance des communs
Timothée Duverger a élargi la perspective vers l’Asie, continent souvent sous-représenté dans les débats sur l’ESS, mais où des dynamiques fortes émergent. En Corée du Sud, l’ESS a été placée au cœur de la relance après la crise politique de 2022, avec des politiques publiques ambitieuses pour les coopératives sociales et les monnaies locales. Au Japon, les coopératives de soins et les fermes communautaires se multiplient, portées par une société civile déterminée à résister à la financiarisation de l’économie. En Inde, les banques communautaires et les systèmes d’entraide rurale (comme les Self-Help Groups) démontrent que l’ESS peut être un outil de démocratisation économique, notamment pour les femmes et les castes défavorisées.
Pour Timothée Duverger, ces exemples asiatiques prouvent que l’ESS n’est pas un modèle occidental exportable, mais une réponse universelle à des crises universelles : « Partout, elle émerge là où l’État et le marché échouent. Son génie est de s’adapter aux cultures locales tout en portant une vision commune : la primauté de l’humain et de la planète sur le profit. »
Vers une “internationale de l’ESS” ?
Quand 70 pays se rassemblent à Bordeaux, la question surgit naturellement : existe-t-il un mouvement mondial de l’ESS ? Les citoyens s’emparent partout du sujet, via les monnaies locales, les coopératives ou les budgets participatifs.
Timothée Duverger souligne que l’ESS est déjà un contre-mouvement transnational face au libéralisme, même si elle se déploie selon des réalités nationales très distinctes, avec des convergences évidentes sur les valeurs, sur les objectifs de justice sociale et de transition écologique, ou sur la montée en puissance des villes dans la co-construction des politiques publiques. Pour lui, l’ESS est déjà une force de résistance globale. Il reste à passer à l’échelle supérieure : « Nous avons les outils, les réseaux, les succès. Il nous manque une stratégie commune pour faire mouvement. »
Aude Saldana, qui coordonne le réseau des métropoles du GSEF, observe très justement cette convergence territoriale : des gouvernements locaux qui innovent, qui partagent leurs pratiques et qui inventent des modèles hybrides. Mais elle souligne une autre force motrice, considérable : celle des jeunes, porteurs d’une ESS renouvelée.
Un temps fort du GSEF 2025 aura été la Déclaration internationale des jeunes pour l’ESS, portée par 70 jeunes venus de 10 pays européens. Aude Saldana, secrétaire générale du GSEF, y voit un tournant : « Les jeunes ne veulent plus être des bénéficiaires passifs. Ils exigent d’être co-constructeurs des politiques publiques. » Et parce que cette génération réclame une place permanente dans les instances de gouvernance de l’ESS, le GSEF a institutionnalisé un pôle jeunesse dans sa gouvernance, une première pour un forum mondial. Car, conclut Aude Saldana, « l’ESS doit sans cesse se réinventer pour rester pertinente ».
Voir notre émission en intégralité :