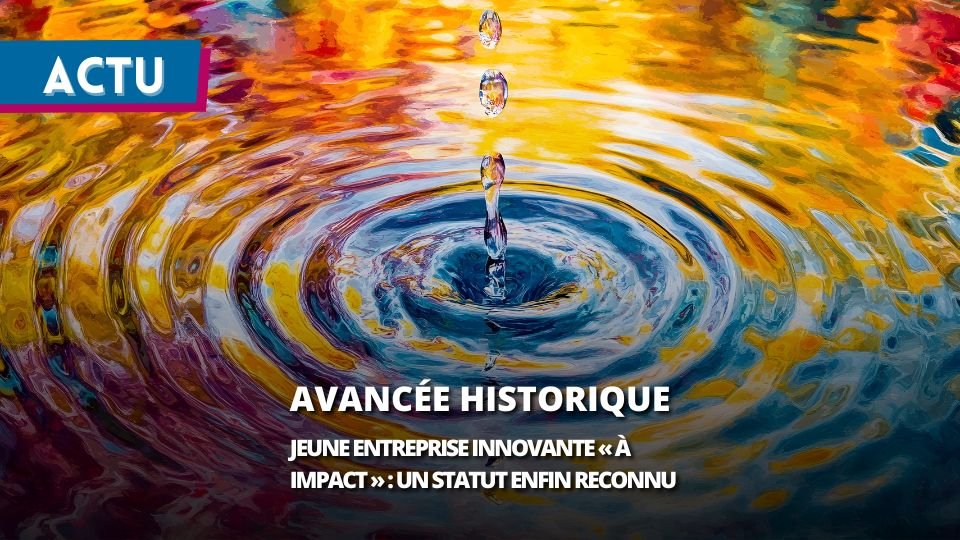Détricotage final, ou sursaut de dernière minute ? L’avenir du Green Deal se joue cette semaine au Parlement européen. Et les derniers échos n’augurent rien de bon pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, du développement durable et de la transition sous toutes ses formes. Après des années de progrès en matière d’ambition environnementale, sociale et démocratique du projet européen, comment en est-on arrivé là ? Petit retour en arrière.
Le Green Deal, c’est le “pacte vert pour l’Europe”, une stratégie de croissance pour l’Union européenne lancée en 2019, composée d’un ensemble de mesures visant à engager l’UE sur la voie de la transition écologique, afin d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Naturellement, cette stratégie impose des contraintes aux producteurs et aux consommateurs. La Commission européenne, renouvelée en 2024, n’a pas souhaité rester sourde aux inquiétudes.
Voici donc que la directive Omnibus, lancée en février dernier par la Commission européenne, entend “simplifier” les règles issues du Green Deal pour alléger la charge administrative des entreprises. Une aubaine pour les forces conservatrices : elles ont mis le pied dans la porte en prétextant que chaque mesure de progrès social ou environnemental contenue dans le Green Deal était un “charge” économique, au détriment de la compétitivité.
De la “simplification” à la dérégulation
Résultat, après huit mois de négociations, la “simplification” du Green Deal proposée dans la directive Omnibus ressemble à une dérégulation totalement assumée par les partis européens de droite et d’extrême-droite. Le compromis validé la semaine dernière par la commission des affaires juridiques du Parlement européen affaiblit deux grands piliers du Green Deal : la directive CSRD (reporting de durabilité) et la directive CS3D (devoir de vigilance des entreprises).
En résumé, les entreprises auraient moins besoin de justifier leurs décisions néfastes au plan social ou environnemental (90% des entreprises seraient exemptées de reporting) et elles se sentiront moins responsables des dégâts que pourraient causer leurs fournisseurs (70% ne seraient plus concernées par le devoir de vigilance).
Le compromis supprime également l’obligation pour les grandes entreprises d’adopter un plan de transition climatique, ainsi que le régime de responsabilité civile européen qui permettait aux victimes de violations des droits humains ou environnementaux d’obtenir réparation. Le vote du texte final de ce compromis aura lieu cette semaine au Parlement européen et servira de base au futur Green Deal européen édulcoré.
Les réactions face au détricotage
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a levé toute ambiguïté le 1er octobre en assumant : « Quand nous parlons de simplification, nous parlons de dérégulation. » Un véritable basculement idéologique, par lequel la Commission cherche à s’aligner sur les États-Unis où les exigences de reporting extra-financier sont bien plus faibles qu’en Europe. Et cela, alors qu’un récent sondage européen confirmait que la majorité des entreprises européennes soutiennent le maintien de règles de reporting et de vigilance plus strictes que les propositions de l’Omnibus.
Autant de reculs dénoncés par les eurodéputés écologistes et sociaux-démocrates. Ce compromis est « un virage assumé vers la dérégulation, au détriment des droits sociaux, de l’environnement et de l’économie européenne », déplore l’eurodéputée française Marie Toussaint.
« Nous assistons à un retour en arrière historique », regrette pour sa part Andreas Rasche, professeur à la Copenhagen Business School. « L’Europe sacrifie sa responsabilité à long terme pour un gain politique immédiat. »
Maître de conférences à AgroParisTech et codirecteur des chaires “Comptabilité écologique” et “Double matérialité », Alexandre Rambaud réagit également : « L’Union européenne abdique son rôle de puissance normative. Elle renonce à être un moteur de durabilité mondiale au moment même où les entreprises elles-mêmes réclament des cadres plus exigeants. »
Pourquoi les acteurs de l’ESS sont également concernés
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire regardent pour beaucoup ce débat à distance, considérant que seules les grandes entreprises sont concernées. Mais ces reculs européens ne sont pas qu’un débat technocratique : ils remettent en cause le cadre de responsabilité qui structure le modèle économique de tous les acteurs de la transition, à commencer par ceux de l’ESS.
Les normes de durabilité, la comptabilité extra-financière ou les obligations de vigilance, si elles sont renforcées, créent un terrain de jeu plus équitable entre les entreprises classiques et celles de l’ESS, qui intègrent depuis toujours les dimensions sociales et environnementales dans leur gouvernance.
En affaiblissant ces obligations, l’Union européenne désavantage les modèles vertueux au profit de la compétition par les coûts. « Ce n’est pas la bureaucratie qu’on allège, c’est la responsabilité qu’on efface », résume un acteur du réseau européen Social Economy Europe. Pour l’ESS, la durabilité n’est pas un fardeau : c’est une raison d’être.