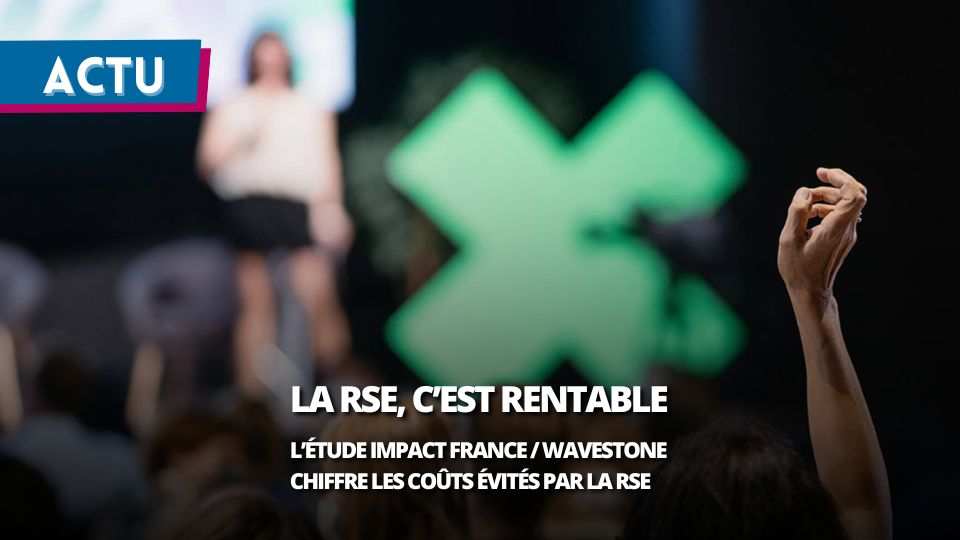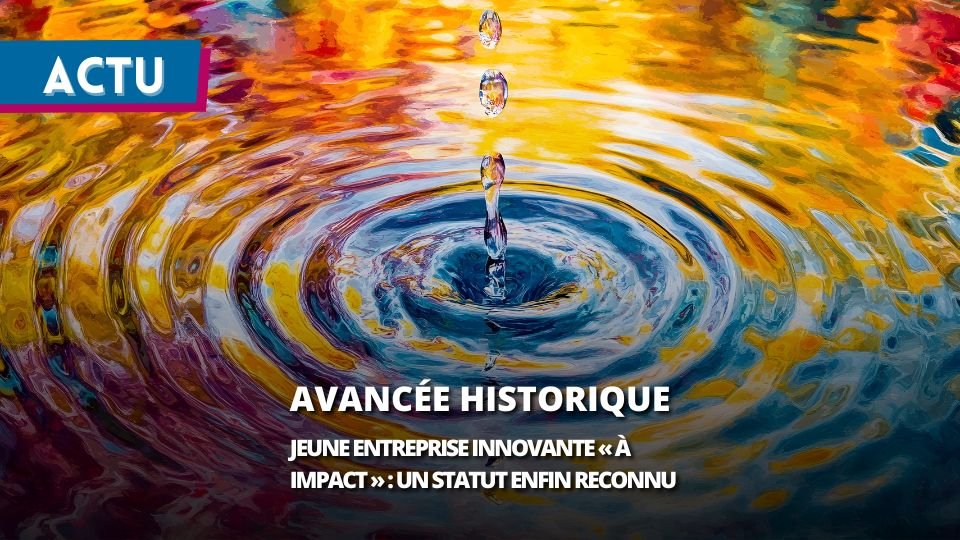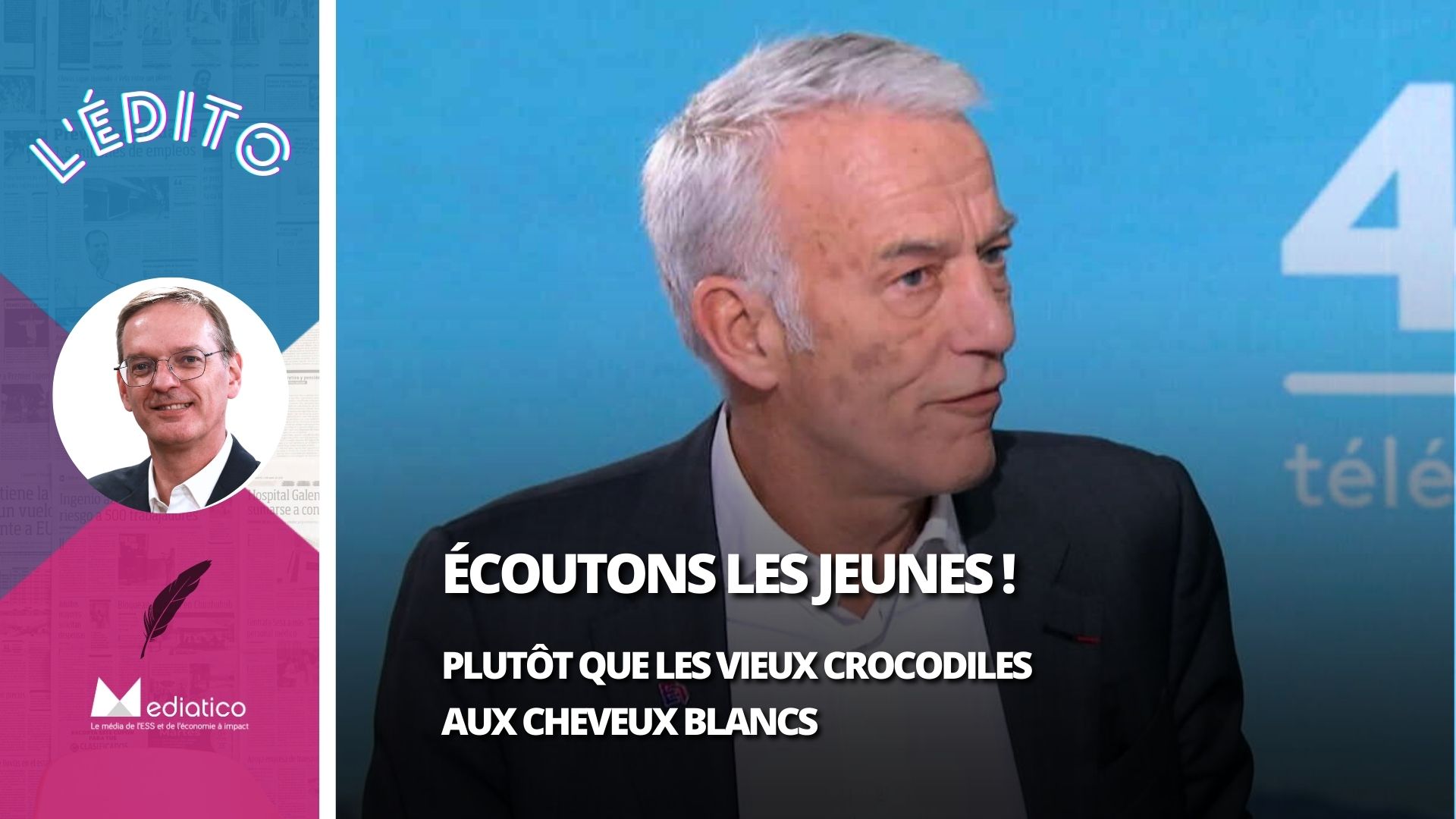On peut lire une ville comme on lit une époque. Ses rues, ses places, ses façades racontent l’histoire du tissu économique qui l’a façonnée : ateliers, commerces, usines, vergers, entreprises, lieux culturels, écoles, hôpitaux. L’économie dessine la géographie, les usages et la population d’une ville.
J’ai grandi à Boulogne-Billancourt au début des années 1980. À l’époque, les usines Renault faisaient vivre près de 4 000 ouvriers sur l’Île Seguin. Quand elles ont fermé en 1992, ce site industriel s’est mué en pôle créatif et numérique, entouré de bureaux, d’immeubles de standing et d’un éco-quartier. Les petites maisons ouvrières sont devenues des biens très prisés, aux tarifs inaccessibles. La ville a changé de visage pour attirer cadres et classes moyennes aisées.
C’est un schéma que l’on observe ailleurs en France : désindustrialisation, reconversion, montée de la ville « durable » ou « intelligente ». L’aménagement urbain reflète toujours des choix politiques et économiques. Derrière chaque quartier réaménagé, chaque zone d’activité, se cache une vision du développement, de l’attractivité, et désormais de l’adaptation au changement climatique. Objet technique et politique, la ville est organisée, planifiée, dessinée. Mais une question demeure : ces choix répondent-ils vraiment aux besoins de tous les habitants ?
Vers une économie du lien et du soin
J’ai travaillé cinq ans dans des tiers-lieux. Ces espaces hybrides, modulaires, expérimentaux, toujours en mouvement. Souvent implantés dans des gares désaffectées, d’anciennes écoles ou hôpitaux, ils redonnent vie à des friches en accueillant des cafés partagés, des espaces culturels ou des fermes urbaines. Ce sont des lieux de travail, de création, de convivialité, de commerces responsables. On y croise tous les publics de la ville : des travailleurs indépendants, des habitants du quartier, des artistes, des personnes vulnérables
Et ce que j’y ai vu est frappant : ces lieux font du bien. Ils ne cherchent pas à répondre aux impératifs d’une économie à but lucratif, ils inventent une économie pour fabriquer du lien, de l’entraide, de la dignité. Pour accueillir les fragiles, les débrouillards, les rêveurs. Pour agir, créer, se retrouver. Ils expérimentent des manières de vivre ensemble. Ce sont des communs, pas des centres commerciaux. Leur but n’est pas la recherche du profit, mais de profiter à tous les habitants.
C’est là qu’intervient l’économie sociale et solidaire (ESS). Derrière ce terme administratif hérité de la loi de 2014, se cache une réalité foisonnante : des associations, des coopératives, des mutuelles, des collectifs citoyens. Leur logique est inverse de celle de l’économie capitaliste : d’abord identifier un besoin social ou écologique, ensuite créer une activité pour y répondre, et enfin la rendre viable économiquement, sans jamais faire du profit une fin en soi.
L’ESS, déjà l’avenir des villes
Les exemples sont nombreux. Commerces responsables (épicerie locale et bio, friperie, ressourcerie, restaurants, artisans) ; ateliers de réparation de vélos, fablabs, jardins partagés, fermes pédagogiques ; services de collecte, de tri, de distribution de denrées alimentaires ; locaux associatifs accueillant les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les personnes en situation de handicap ; lieux d’apprentissage et de formation (chantiers d’insertion, ateliers), de résidence et de création artistique, de travail, ouverts sur la ville. Rien de spectaculaire, mais tout ce qui rend une ville réellement habitable.
Parce qu’elle répond à des besoins concrets, l’ESS incarne la modernité. Elle est une économie de proximité, de résilience, de bon sens. Une économie du lien et du soin. Et pourtant, elle reste trop souvent cantonnée aux marges des politiques urbaines.
Alors que va s’ouvrir le Salon des Maires et des Collectivités, et à six mois des élections municipales, les candidats aux élections doivent se poser la question : quelle place donner dans leur ville à ces acteurs économiques du quotidien, jeunes, investis, ancrés et porteurs des innovations sociales et environnementales ?
Les élus ont une responsabilité immense. Soutenir l’ESS, ce n’est pas aménager les marges : c’est choisir une orientation politique claire, celle d’un développement territorial plus juste, plus durable, plus démocratique.
Quelques pistes très concrètes
- Réserver du foncier à prix juste pour les projets ESS en centre-ville.
- Reconnaître les communs comme des infrastructures d’intérêt général : un café coopératif, une ferme urbaine ou un atelier artisanal sont aussi attractifs qu’un centre commercial.
- Intégrer les acteurs de l’économie circulaire dans la logistique urbaine.
- Faciliter l’accès des structures ESS aux marchés publics
Ces leviers ne coûtent pas plus cher : ils déplacent simplement le curseur vers des choix qui bénéficient au plus grand nombre, pour construire la ville de demain.
Une ville qui fait envie
La bonne nouvelle, c’est que cette ville existe déjà. Par petites touches, des municipalités expérimentent les budgets participatifs, soutiennent des associations qui redonnent vie à des lieux de patrimoine et de culture, accompagnent des projets entrepreneuriaux de l’ESS. De leur côté, des habitants se rassemblent pour répondre aux besoins qu’ils identifient sur leur territoire : faire le pont entre générations, entre cultures, entre solitudes. Ce sont ces initiatives qu’il faut renforcer et mettre au cœur du jeu.
S’engager pour l’économie sociale et solidaire, c’est dessiner une ville vivante. Pas une ville qu’on quitte quand on en a les moyens, mais une ville où l’on a envie de rester parce qu’on y est acteur.
À l’heure où se préparent les municipales, au lieu de demander quelle est la place de l’ESS dans la ville, reconnaissons que c’est l’économie sociale et solidaire qui dessine la ville de l’avenir.
Marie Floquet, directrice générale, Les Canaux.