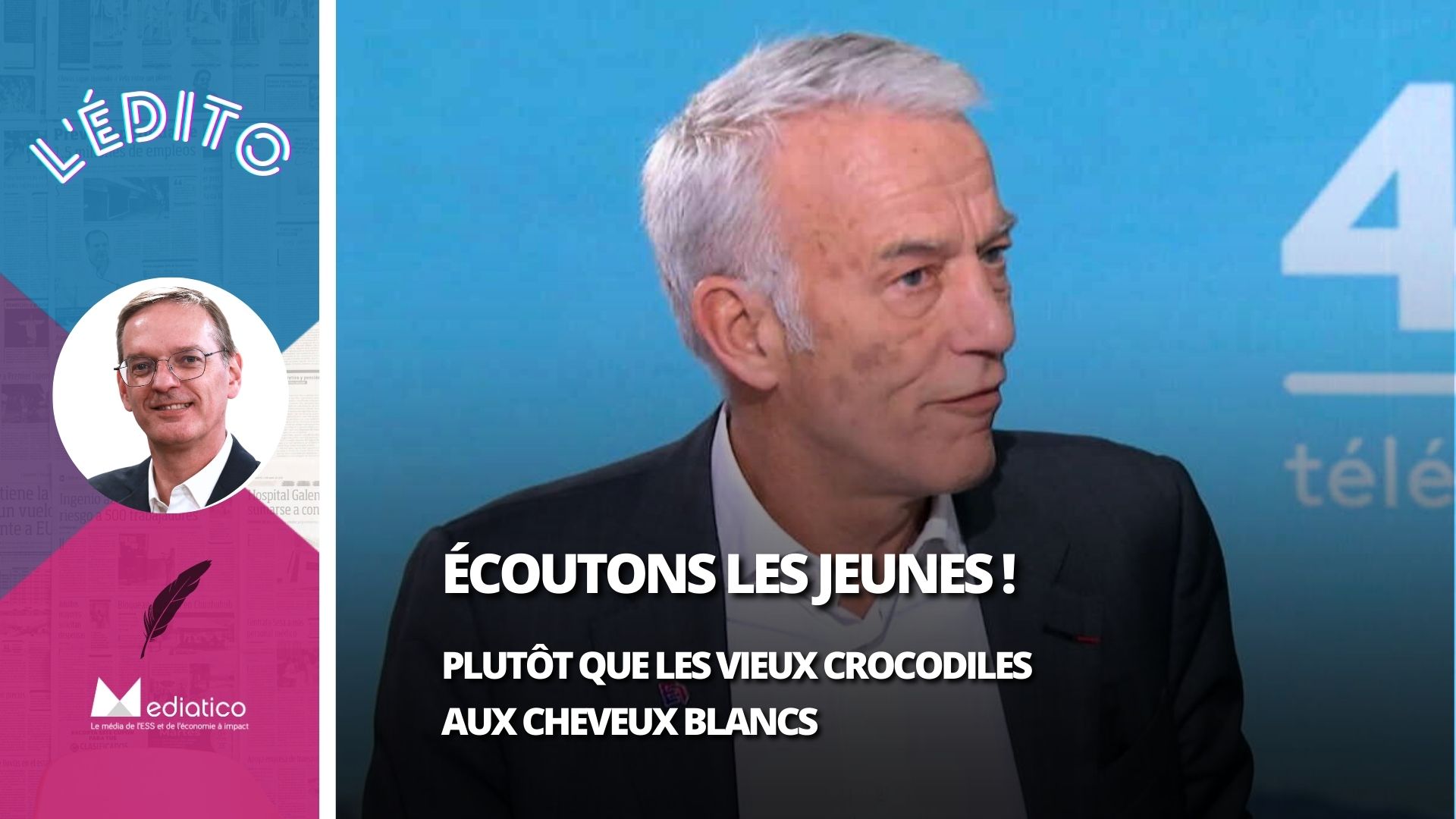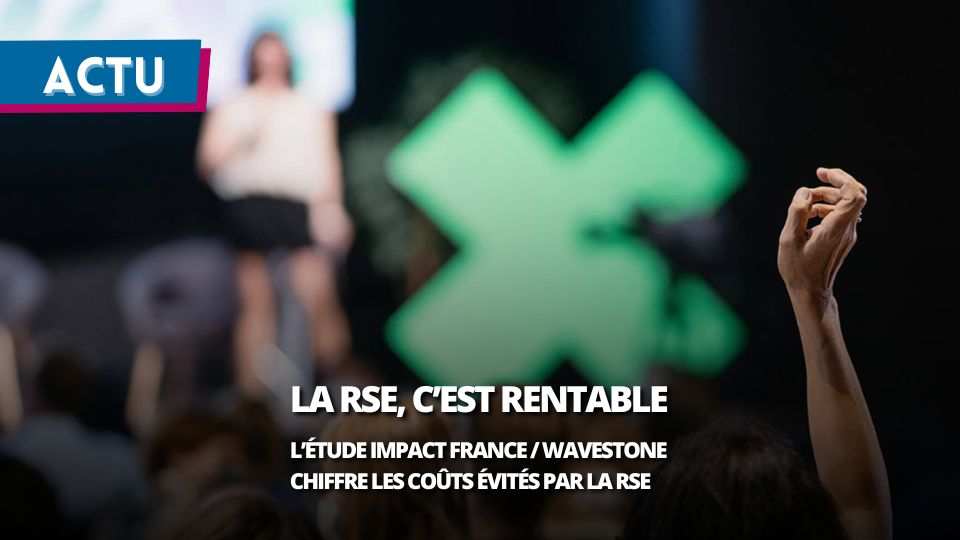La Banque des Territoires, en partenariat avec Intercommunalités de France et Régions de France, a dévoilé récemment une étude inédite montrant que l’économie sociale et solidaire (ESS) peut être l’un des piliers de la réindustrialisation française. Grâce à ses valeurs coopératives, son ancrage territorial et sa finalité d’intérêt général, l’ESS apparaît comme une réponse crédible aux défis sociaux, économiques et environnementaux que pose le renouveau industriel dans les territoires.
Fondée sur près de quatre-vingts entretiens menés auprès d’acteurs de terrain — industriels, associations ESS, collectivités, éco-organismes — cette enquête met en lumière des freins persistants mais aussi des leviers concrets pour que les structures de l’ESS passent à l’échelle industrielle. L’étude analyse comment les coopératives, les entreprises d’insertion et d’autres structures sociales capables de produire peuvent porter une “réindustrialisation autrement”, centrée sur des emplois non délocalisables et des filières plus durables (télécharger l’étude).
Un potentiel encore largement sous-exploité
Selon le rapport, l’ESS représente déjà 10 % du PIB français et 14 % des emplois du secteur privé, mais seulement environ 1,3 % de l’emploi industriel. Parmi les structures industrielles de l’ESS, deux tiers sont des coopératives, ce qui témoigne d’une forte tradition de gouvernance partagée. Certaines de ces organisations — entreprises adaptées, GEIQ, ESAT — mènent déjà des activités industrielles : production, transformation, économie circulaire, logistique, ou services RH liés à l’insertion.
L’étude montre que l’ESS bénéficie d’un véritable potentiel de relocalisation d’activités, d’innovations sociales et d’emplois “résilients” : les emplois qu’elle peut générer sont profondément ancrés sur les territoires. Plusieurs initiatives locales montrent que la réindustrialisation via l’ESS n’est pas un vœu pieux :
- Dans le Grand Est, le groupe coopératif d’insertion Valo a remporté un appel d’offres pour assurer la collecte de cartons en mobilité douce dans la Métropole du Grand Nancy, combinant logique industrielle, insertion et transition écologique.
- L’étude suggère également que les PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Économique) peuvent être des machines à “ESS-iser” l’industrie, en rapprochant les filières locales, les acteurs publics et les entrepreneurs sociaux.
Freins à lever : ce que révèle l’enquête
Malgré ces atouts, l’étude identifie plusieurs obstacles majeurs qui freinent la montée en puissance industrielle de l’ESS. Un premier frein tient à la méconnaissance mutuelle : les entreprises industrielles traditionnelles et les structures de l’ESS peinent à se comprendre, ce qui limite l’émergence de partenariats. La question de l’investissement se pose aussi, car les modèles économiques hybrides et les statuts associatifs ou coopératifs compliquent l’accès aux financements “classiques”.
L’accès au foncier industriel constitue un autre verrou. Le coût élevé, la rareté des terrains bien situés, ou encore l’inadaptation des espaces existants pèsent lourdement sur les ambitions des entreprises sociales. Enfin, le recrutement et la fidélisation de salariés qualifiés dans des métiers industriels sont particulièrement difficiles : les ESS doivent concilier leur mission sociale avec des contraintes de masse salariale, ce qui peut limiter leur attractivité.
Les leviers identifiés : une stratégie pour faire évoluer l’industrie
Pour dépasser ces obstacles, l’étude propose différentes pistes d’action. Elle insiste particulièrement sur la nécessité de renforcer les coopérations économiques entre les entités de l’ESS et les industriels “classiques” : il ne s’agit pas seulement de sous-traitance, mais aussi de partenariats stratégiques, de mentoring, de co-construction de chaînes de production locales.
Les auteurs recommandent également d’adapter les outils financiers, en modulant les mécanismes d’investissement pour les rendre compatibles avec les modèles coopératifs ou d’insertion. Dans le même temps, ils appellent à une politique foncière active : les collectivités pourraient jouer un rôle clé en facilitant l’accès des structures ESS à des friches industrielles ou à des bâtiments existants, voire en développant des foncières solidaires.
Par ailleurs, l’étude met en avant l’idée d’“ESS-iser” les filières industrielles : cela passe par des achats responsables, des critères sociaux et environnementaux dans les aides publiques, et des gouvernances plus inclusives dans les organisations. Enfin, l’ESS est perçue comme un acteur stratégique pour le recrutement dans l’industrie : en formant et en fidélisant des talents locaux, elle peut devenir un vivier précieux de compétences.
Des initiatives concrètes sur le terrain
La Banque des Territoires a déjà mis en place des programmes concrets pour soutenir cette ambition. Elle propose des prêts et des investissements pour aménager des sites industriels, financer des friches, développer des infrastructures liées à la mobilité, à l’énergie ou à la formation, et sécuriser juridiquement des projets via des mécanismes de consignation.
Un autre levier-clé : l’outil Friches+, lancé par la Banque des Territoires avec le soutien de l’Union européenne. Il permet d’identifier et de requalifier des friches industrielles à travers la France, offrant des terrains potentiels pour des projets ESS industriels.
Une ambition politique forte
La Banque des Territoires rappelle que la réindustrialisation ne peut plus être une logique uniquement économique : elle doit être sociale, écologique et démocratique. Dans cette perspective, l’ESS est appelée à prendre davantage de place dans les comités de filières, aux côtés des industriels traditionnels, mais aussi dans les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). L’idée est de faire de chaque territoire un laboratoire d’innovation industrielle, capable de produire “autrement” et de créer des emplois non délocalisables.
L’étude de la Banque des Territoires redessine les contours d’une réindustrialisation non pas fondée sur le tout-production, mais sur la durabilité, la justice sociale et l’ancrage territorial. L’économie sociale et solidaire n’y apparaît pas comme une simple alibi, mais comme un acteur stratégique et crédible. Pour réaliser cette vision, les collectivités, les industriels et les structures de l’ESS devront coopérer, adapter leurs outils, et bâtir des modèles tournés vers l’intérêt général.