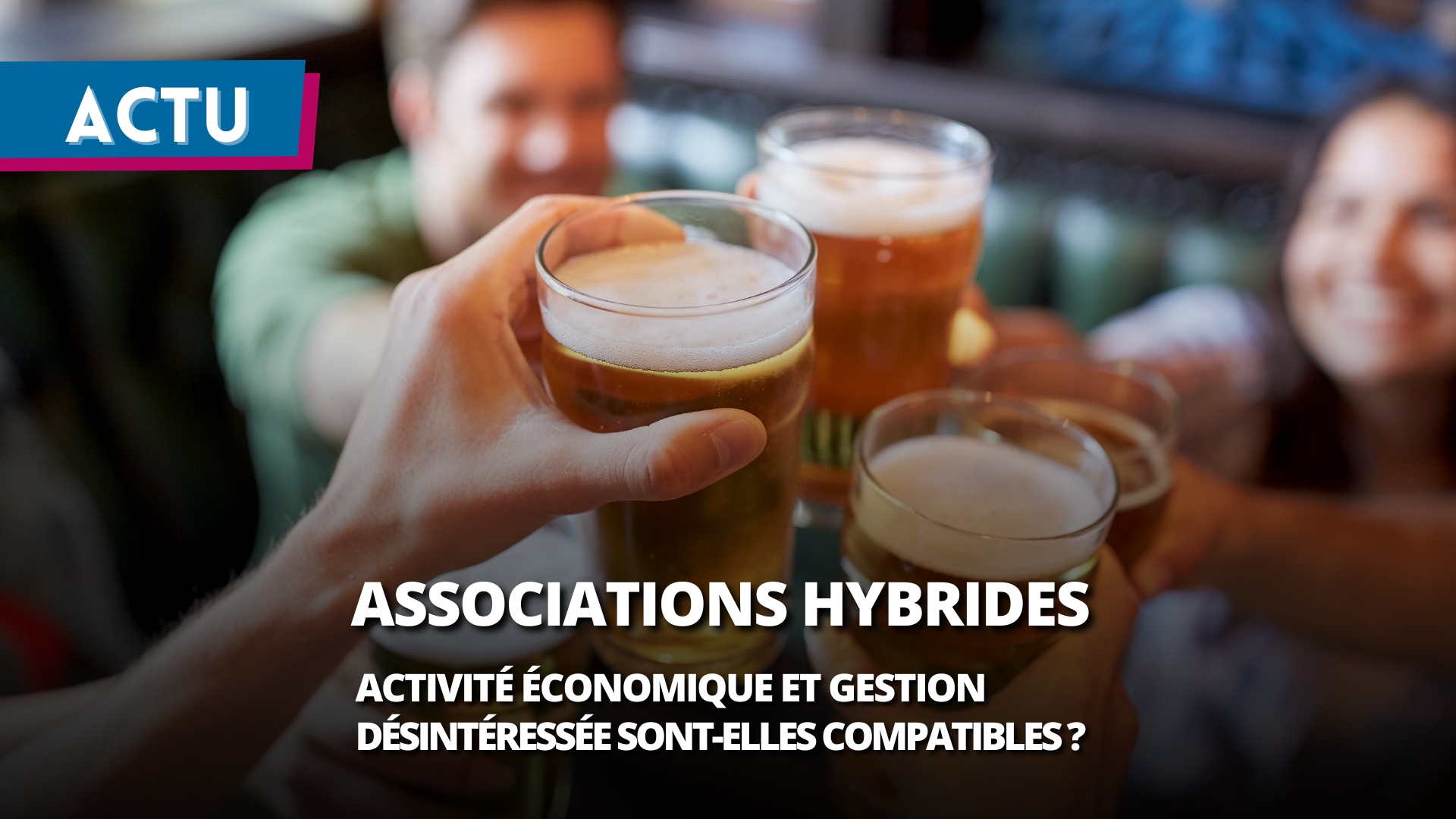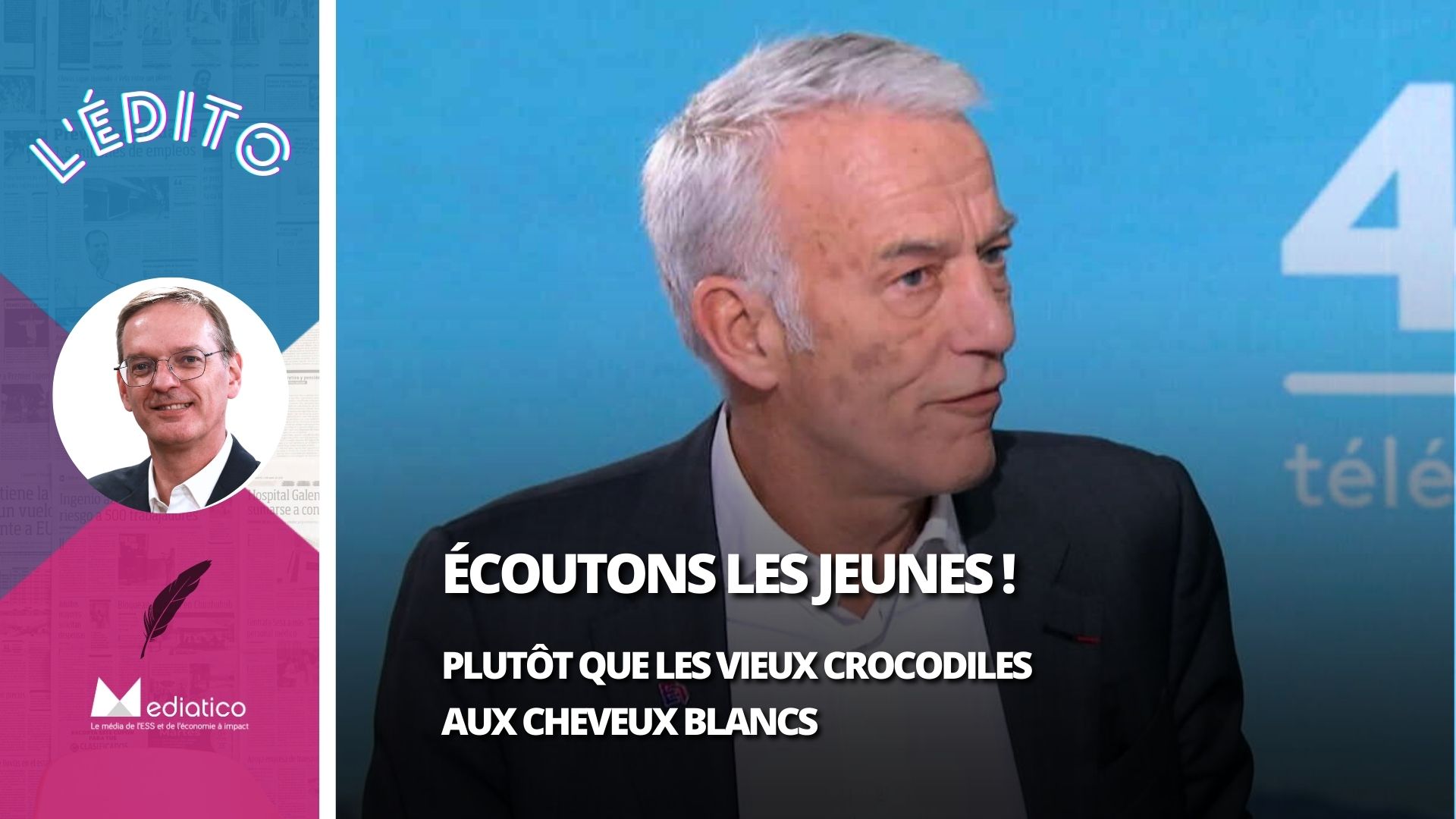Peut-on encore définir clairement ce qu’est l’« intérêt général » ? La réponse est non, estime le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), dans un rapport publié discrètement fin juin, intitulé « Des propositions pour reconnaître, soutenir et encourager la contribution des associations à l’intérêt général dans un contexte concurrentiel ».
L’instance consultative y tire la sonnette d’alarme : la notion d’intérêt général est aujourd’hui trop floue, réduite à une lecture fiscale et comptable, au détriment de sa portée sociale et démocratique. Or, les associations, qui représentent une part majeure de la société civile organisée, sont directement concernées. A fortiori, celles qui sont actives dans le champ concurrentiel, en première ligne face au secteur privé.
Une définition trop étroite de l’intérêt général
Aujourd’hui, la reconnaissance de l’intérêt général repose largement sur un critère de non-lucrativité, explique le HCVA. En clair, une association est exonérée d’impôts si elle n’entre pas en concurrence avec des acteurs privés. Mais pour le HCVA, cette approche est insuffisante : l’intérêt général ne peut pas se réduire à une comparaison avec l’économie marchande.
L’intérêt général, rappelle le rapport, englobe aussi l’utilité sociale, la capacité à agir auprès des publics fragiles, l’innovation associative et la vitalité démocratique des territoires. En rester à une lecture fiscale, c’est négliger l’essence même de l’action associative, au risque de fragiliser des milliers de structures qui inventent chaque jour des réponses nouvelles aux besoins collectifs.
L’activité économique, jugée compatible avec une gestion désintéressée
Or, contrairement à une idée reçue, développer une activité économique n’est pas contradictoire avec la gestion désintéressée d’une association, poursuit le HCVA, qui le rappelle fermement : ce qui compte, c’est la finalité. Tant que les excédents sont réinvestis dans le projet collectif, l’association reste fidèle à l’intérêt général.
Cette clarification est essentielle, car de plus en plus d’associations doivent diversifier leurs ressources pour survivre. Vente de prestations, création de filiales, voire partenariats commerciaux : ces leviers ne devraient pas mettre en danger leur statut.
Le rapport propose ainsi d’assouplir le régime fiscal des activités dites “accessoires” et de sécuriser juridiquement les montages hybrides, afin que les associations puissent développer des modèles économiques solides sans crainte d’être requalifiées en entreprises lucratives.
Pour un fonds national de soutien à l’innovation associative
Les associations sont par ailleurs souvent les laboratoires de l’innovation sociale. Qu’il s’agisse de protection de l’enfance, d’accompagnement des personnes âgées, d’éducation populaire ou encore de transition écologique, elles sont à l’origine d’initiatives qui inspirent ensuite les politiques publiques.
Mais leur contribution reste peu reconnue par la société et encore moins financée par la puissance publique. Le HCVA recommande donc la création d’un fonds national de soutien à l’innovation associative, ou à défaut la mobilisation du Fonds de développement de la vie associative (FDVA). Une façon de mieux valoriser ce rôle pionnier, alors que les associations se trouvent souvent en première ligne pour répondre aux crises sociales et environnementales.
Reconnaissance constitutionnelle et européenne
Le HCVA plaide enfin pour une double reconnaissance des spécificités associatives de notre époque, à la fois dans la Constitution et au niveau européen.
En France, il propose d’inscrire dans la Constitution une mention explicite : « La République reconnaît et soutient les actions des associations au service de l’intérêt général. » Ce geste symbolique aurait une portée politique forte, en affirmant que les associations sont des piliers de la démocratie et non de simples prestataires de services.
Au niveau européen, le HCVA appelle à faire évoluer le droit de la concurrence et des aides d’État, pour mieux prendre en compte les spécificités des associations. L’objectif est que la Commission européenne adopte une définition partagée de l’intérêt général dans tous les pays européens et reconnaisse la valeur particulière des services sociaux portés par les acteurs non lucratifs.
Une feuille de route pour l’avenir associatif
Au total, le rapport formule 19 propositions, allant de l’intégration du HCVA dans le processus de rescrit fiscal à l’actualisation de la liste des activités d’intérêt général reconnues dans le BOFiP. Plus largement, il invite à ouvrir un dialogue structuré entre l’État, les associations et les instances européennes, pour redonner toute sa place à l’action associative dans l’intérêt général.
Dans un contexte de raréfaction des financements publics et de concurrence accrue avec les acteurs privés, ce rapport trace une feuille de route ambitieuse. Il s’agit moins de défendre un « secteur » que de reconnaître une contribution essentielle au bien commun : celle de millions de bénévoles et de salariés associatifs qui, chaque jour, renforcent le lien social, accompagnent les plus fragiles et inventent des solutions pour demain.
Lire le rapport du HCVA :
https://andiiss.org/wp-content/uploads/2025/07/TECH-rapport-vie-associative.pdf